Parfois… je crois que j’aime mes manuscrits plus que les gens qui m’entourent.
Quoi ? Impossible ? Mais si, suivez le guide !
Parfois… je crois que j’aime mes manuscrits plus que les gens qui m’entourent. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça.
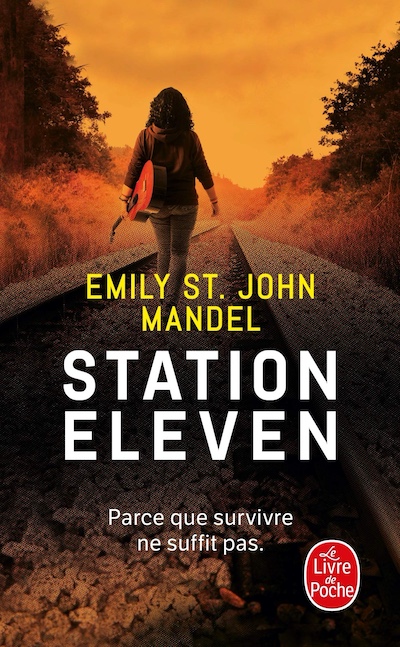
Cette prise de conscience m’est venue en lisant Station Eleven de Emily St. John Mandel. Dedans, il y a cette scène où Miranda préfère rester travailler sur son roman graphique plutôt que de rejoindre l’homme qu’elle aime. Ce qu’il ne comprend pas évidemment car pour lui, son œuvre… c’est pas au mieux un passe-temps, au pire le gâchage de son talent.
Pour elle par contre, cette oeuvre est un appel qui remonte de ses entrailles, un besoin de créer, pour exister. Elle y tient tellement qu’à l’aune de cet amour, elle se rend compte qu’elle ne tient plus à son amoureux (qu’est un peu un sale type d’ailleurs).
En lisant ces lignes, je me suis reconnue en elle (pour la partie attachement à l’oeuvre hein, pas le reste !)?
Et donc je me suis demander si on peut aimer un livre, une histoire, un projet créatif au point d’en oublier d’aimer les gens qui nous entourent ?
Parce que bon, quand j’écri, tout s’efface un peu autour de moi. Le temps devient élastique. Le monde réel se transforme en bruit de fond. Les autres ne sont plus que des silhouettes floues. Enfermé dans la création et dans son plaisir, ou dans sa concentreation, on en oublie ceux qui nous aiment.
Et eux peuvent ne pas comprendre pourquoi on passe tant d’heures devant notre écran. Ils pensent qu’on s’isole, qu’on se moque de ce qui leur arrive alors qu’en fait, on se trouve juste ailleurs. Au milieu d’autres personnes, nos personnages.
Est-ce que c’est ça être écrivain ?
Est-ce que c’est cet égoïsme qui nous pousse à témoigner d’événements fictifs au détriment de la vie réelle ?
Est-ce que c’est cette espèce de schizophrénie qui nous amène à vivre simultanément dans plusieurs mondes, où on aime à la fois des gens en chair et en os et des fantômes numériques qu’on a créés de toutes pièces ?
Y a un piège là, je crois.
On se dit qu’on écrit pour les autres, pour partager, pour créer du lien. Mais au fond, au tout début, on écrit d’abord pour soi. Pour cette satisfaction presque physique de voir les mots s’aligner, les phrases prendre forme, les personnages prendre vie. Et cette satisfaction-là, elle est tellement intense qu’elle peut éclipser tout le reste.
D’autant que les histoires qu’on se raconte, et qu’on raconte, elles ne me quittent jamais vraiment : quand je referme l’ordi, quand je mate un film ou lis livre, mon cerveau continue de turbiner dessus. Elles tournent, bouclent, se rejouent à la recherche d’un point faible, d’une faille logique ou d’une scène un peu plus meilleure. C’est difficile de déconnecter.
Y aussi un autre piège : ces histoires sont comme des mondes parallèles qui m’accueillent peu importe l’heure, peu importe mon état. Il n’y a dans notre relation, jamais de mauvaises humeurs, d’engueulades ni de jalousie. Les sentiments qu’elles convoquent sont hyper positifs (ce qui est hyper dangereux : qui voudrait quitter une safe place pour un monde tel que le notre ? En pleine voie d’autodestruction ? ) Les personnages font ce que je veux. Pas de tensions, de compromis, de prises de tête. C’est une relation hyper confortable. Peut-être trop confortable.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu’écrire et vivre sont antinomiques ? Est-ce qu’on doit faire un choix ? Est-ce qu’on peut pas vivre à la fois la fiction et le réel ?
Y a quelque chose qui me dérange dans cette opposition entre création et relation. Comme si c’était forcément l’un ou l’autre. Comme si aimer ses histoires empêchait d’aimer les gens.
Peut-être que le problème, c’est pas d’aimer trop fort ce qu’on écrit. Peut-être que c’est de ne pas savoir expliquer cet amour-là aux gens qui nous entourent. De ne pas arriver à leur faire comprendre que nos histoires, c’est pas une échappatoire. C’est une façon de comprendre le monde. De le digérer. De lui donner du sens.
Quand j’écris, je ne fuis pas la réalité. Je la transforme. Je la teste. Je la pousse dans ses retranchements pour voir ce qui se passe. Et ce que je découvre dans mes histoires, ça me sert aussi dans la vraie vie. Mes personnages m’apprennent des choses sur moi-même, sur les autres, sur ce qui nous lie.
Alors peut-être que la vraie question, c’est pas : « Est-ce qu’on peut trop aimer ce qu’on écrit ? » mais peut-être que c’est : « Comment on partage l’amour entre ces deux pans de vie ? »
Peut-être que c’est ça le secret : aimer de plusieurs façons à la fois. Aimer les gens pour ce qu’ils sont, et aimer les histoires pour ce qu’elles révèlent de nous.
