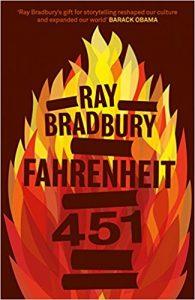 Donner son avis sur Fahrenheit 451, c’est un peu comme faire un discours lors d’un repas de famille. Tout le monde vous regarde, et vous avez ce poids là, sur la poitrine, qui vous pèse. Vous vous sommez de ne pas bafouiller, et bafouiller s’insinue dans votre esprit, dans votre mâchoire, dans les muscles qui la commandent. Vous faites tinter votre verre avec votre fourchette, et le silence se fait.
Donner son avis sur Fahrenheit 451, c’est un peu comme faire un discours lors d’un repas de famille. Tout le monde vous regarde, et vous avez ce poids là, sur la poitrine, qui vous pèse. Vous vous sommez de ne pas bafouiller, et bafouiller s’insinue dans votre esprit, dans votre mâchoire, dans les muscles qui la commandent. Vous faites tinter votre verre avec votre fourchette, et le silence se fait.
Et là, ça criant.
Ça craint parce que quoi que vous disiez, vous connaissez l’avis des autres (et la vie des autres, mais ça, c’est une autre histoire).
Un petit tour sur Babelio montre que les 3/4 des lecteurs l’ont aimé (1/4 de cons qui se sentent bien seuls…). La lecture de leurs critiques permet de constater combien tout le monde va dans le même sens. Montag, les livres, la propagande, la diversion (ou le divertissement), la résistance, le savoir, la guerre, etc. Tout le monde voit, aime et crie au monde que ce livre est une tuerie.
Ajoutons à cela que l’oeuvre est suffisamment marquante/majeure, pour que deux adaptations aient eu lieux, et nous voilà prêt à tenir notre discours devant l’ensemble de la famille qui n’attend que ça…
— Heu… C’livre, c’est quand même une grosse bouze !
Blam.
Papi fait un infarctus, mamie s’évanouit, maman pleure en implorant les dieux sur le pourquoi, POURQUOI, elle a eu un enfant si débile, et papa prépare son martifouet, pour vous ravager la trogne pendant quelques heures.
Voilà, il ne fallait pas ne pas aimer ce livre.
Mais non, réveille toi, tout ceci n’était qu’un rêve. Revenons en au livre, posément. Et parlons-en.
L’antagonisme.
Le livre nous présente une guerre à deux fronts :
– l’ennemi extérieure, dont on suppose l’existence, et qui est sans doute les Russes, si l’on se réfère à l’époque à laquelle écrit Bradbury. Alors, il ne les nomment pas. C’est bien. Parce que ça permet de faire entrer le livre dans une temporalité qui lui est propre. Chaque lecteur peut y lire l’ennemi du moment dans lequel il lit (je suis pas sûr d’être clair).
– l’ennemi intérieur, qui n’a pas, non plus, de nom dans le roman. Cet ennemi intérieur se caractérise au début du roman par la propriété de livres. Tout propriétaire mérite la prison, voire la mort. Tant qu’à faire. La raison… en filigrane, viendrait du fait que les livres permettent aux individus de s’interroger et donc, de développer un esprit critique. Ce qui les rendrait hermétiques à la propagande ou, dans le cas de ce roman, au fait qu’on cache la guerre aux gens sous prétexte de les rendre heureux. En un mot, on espère construire une nation « divertie » dans le sens où elle ne s’occupe pas de ses soucis premiers.
Le point rigolo est qu’au fur et à mesure du roman, un basculement se fait et l’ennemi devient les pompiers, et, en dézoomant, tous ceux qui participent à abrutir la population.
Ennemi extérieur, ennemi intérieur, on voit que tous se joue sur le contrôle de la communication et donc, des esprits.
Le personnage principal.
Beaucoup pensent que Montag est le personnage principal. C’est faux. Le personnage principal, c’est le livre. Pas le livre en tant qu’oeuvre de fiction, car après tout, dans son univers Bradbury aurait pu saouler les individus à grands coups de pulps tout aussi « divertissant » que le mur (qui est une métaphore XXL de la télévision). Le héros, c’est le livre comme oeuvre de savoir. Et au fond, c’est bien le savoir, la connaissance qui est le personnage principal.
Savoir, c’est se décaler, c’est questionner, c’est mettre en doute, remettre en cause. Autrement dit, c’est permettre aux individus de réfléchir par eux-mêmes, d’élaborer des réflexions et de jauger ce qu’ils vivent.
Le livre le souligne : ce savoir incombe une responsabilité. Celle de choisir. Un état totalitaire laisse peu de choix. Il organise, rythme, cadre. Confier le savoir aux individus dans une société non totalitaire est source d’angoisse. Bien oui : est-ce que je fais le bon choix, le choix de la carrière, de couple, de vie, de ville etc. Tôt ou tard nous serons confrontés à nos choix individuels et jaugés à l’aune de leur pertinence.
Le savoir donc. On peut même dire, la culture.
On le voit à la fin : les livres ne sont plus. Ils sont dans les gens. Dans leur mémoire. Ils ont intériorisé les connaissances et ils pourront les transmettre à nouveau (c’est dommage d’ailleurs qu’aucun n’ait lu Harry Potter).
Les adaptations.
Truffaut.
Extrait : [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=976u_C5XnCc[/embedyt]
Mise en scène pour le moins… dynamique (un peu d’ovolmatine trutru ?)
Dans cette interview, Truffaut a vu dans l’ennemi intérieur les nazis.
https://nos-medias.fr/video/françois-truffaut-parle-de-son-film-fahrenheit-451
La France des années 60 était davantage marquée par l’après guerre que les américains qui était passé à un autre conflit. On voit combien le fait de ne pas nommer l’ennemi permet à chaque époque de lui trouver une correspondance qui lui est propre.
Il a senti l’universalité du message : il suffit d’écouter comment s’est fait le choix des livres à brûler. La destruction culturelle ne concerne qu’un territoire, mais elle touche toutes les cultures présentes dans cet espace.
Le film n’a pas bonne presse. Heureusement, un autre est venu lui succéder en 2018…
Ramin Bahrani lui, s’attaque davantage au livre en tant qu’objet.
Bande annonce :
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mNKwe9k55fs[/embedyt]
Il nous place dans un univers technologique, avec les réseaux sociaux, les likes, les smiley en lieu et place de certains mots, mais surtout, il met en scène des livres dématérialisés, que les gens peuvent copier / uploader / partager. Ça aurait été crétin s’il ne nous plaçait pas dans un futur où le web a été brisé et tous les sites d’informations effacés.
On voit d’ailleurs Montag brûler des disques durs.
Pour le coup c’est très malin.
Par contre il nomme les détenteurs de livres : « les anguilles ». Peut-être un rapport avec la salamandre sur les camions de pompier. Ou un soucis de traduction. Je sais pas…
Malgré tout, le film souffre de défauts, défauts qui viennent de l’oeuvre originale.
Aux chiottes Vogler !
Quand on lit le livre, on se retrouve face à un message. Mais on ne se trouve pas face à une histoire. Les personnages n’ont pas grande profondeur. Leur évolution est très/trop rapide. Les étapes à franchir du héros sont balayées pour aller à l’essentiel. Du coup, le 1/4 de cons du début, sont peut-être des gens qui apprécient les histoires, les personnages, les interactions, et qui ne s’y sont pas retrouvés.
Les personnages en carton.
On est pas gâté.
La nana du début, la droguée dont je n’ai pas retenu le nom, qui me fait penser Luna Lovegood tant elle semble perchée. Elle est dehors, elle glandouille en fumant des pétards au pied de son immeuble, c’est la racaille de cet univers. Il ne lui manque qu’une casquette pour faire peur au pompier 😀
Montag (lundi ?) est un perso concon. Il discute avec une nana, il doute. Il assiste à une crémation, il change de camp. Il sauve des livres, il les montre à tout le monde parce que bon, c’est que dangereux. Puis il se retrouve piéger parce qu’il a fait n’importe quoi, alors il s’enfonce dans l’ânerie. Montag, c’est le tankeur d’une partie de D&D interprété par le planteur de scénar de service.
Le capitaine. Logique, machiavélique, qui tente de jouer les durs et qui finit comme une saucisse lors d’une merguez party (dixit les musclés). Quand t’as un de tes sbires qui déconne, tu t’en méfies… tu le laisses pas se balader en chantant lalala, armé d’un lance-flammes. Enfin moi je dis ça, j’imagine hein.
Le robot chien ? Il est cool lui 🙂
La femme de Montag ? Hystéro à souhait. Qui au fond nous montre que sans réflexion, bin on se sent pas bien. Le divertissement ne nous satisfait pas. Bien au contraire. Et malgré à son addiction aux « murs », elle se sent suffisamment vide pour se suicider. Sad but true.
Le vieux rebelle… Comme disait Perceval : « dans toute bonne histoire, y a un vieux. » Là, c’est lui.
Un fin à la Stephen King !
Vous avez lu Le fléau ? 89 457 pages pour…
Boom
Voilà. L’ennemi extérieur vient tout ravager, mais comme on ne s’est pas vraiment investi côté personnage, on s’en tamponne un peu. D’ailleurs, les survivants eux-mêmes sont un peu en mode : « OSEF, on va The Postman, on va refaire pareil mais avec des livres à l’intérieur de nous-mêmes ».
– Ok les gars, suivez l’oiseau !
– Il retourne au village !
– L’oiseau en s’en moque, suivez la rivière !
Enfin voilà.
Conclusion.
Au sortir de cette lecture, je suis tombé sous le charme du message. J’ai par contre eu plus de mal avec l’histoire. Pour moi, ce bouquin, c’est l’exemple type d’une construction fond/forme et de la difficulté de faire du divertissement qui fait réfléchir. Je le trouve déséquilibré. Pertinent, intelligent, il fait réfléchir, mais on retient davantage le message qu’autre chose. C’est sans doute pourquoi ses adaptations sont aussi laborieuses…
Allez, TchuB !
